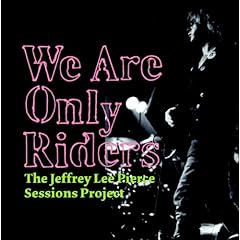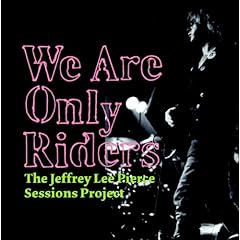
Après une bien longue absence, motivée par un impondérable de taille, le retour sur Between the Lines of Age ne pouvait se faire sur une semi-déception (comme l'album des Strange Boys). Plutôt que de choisir entre les nouveautés que je n'ai pas écoutées, j'ai préféré vanter le mérite d'un disque à part. Qui s'occupe des tributes? A fortiori, qui dira l'intérêt d'écouter un disque hommage à un artiste qu'on ne connait pas? Pas familier du Gun Club - ce qui ne saurait tarder - c'est le nom des invités, et le caractère vraiment exceptionnel de leur rencontre, qui m'a attiré dans cet obscur Jeffrey Lee Pierce Sessions Project. Nick Cave, David Eugene Edwards, Mark Lanegan, les Raveonettes et les Sadies sur un même disque: la nouvelle surprend (mais pas tant, une fois qu'on a compris ce qui les reliait).
Quiconque connait les discrets Sadies - hélas virés country pure et dure depuis un moment - ne voudrait pas rater ça. Pris séparément, chacun des invités n'a pas la même place, évidemment, dans ma discothèque et je ne me vanterai pas d'avoir écouté ou acheté systématiquement leurs derniers disques. La dernière livraison des Raveonettes par exemple ne m'a pas emballé. Si le dernier album de Nick Cave et des Bad Seeds a ses moments (More News From Nowhere) je n'ai pas éprouvé le besoin compulsif de me le procurer. Quant à la chanteuse de Blondie, elle aussi de la partie, son nom n'est pour moi qu'une légère plus-value. Bref, c'est l'aspect collectif qui a attiré mon attention plus que le nom de Jeffrey Lee Pierce.
Les connoisseurs, en revanche, auront bien d'autres raisons de venir picorer ici, car en effet les morceaux présents sur ce tribute n'avaient jamais été diffusés auparavant. Ils viennent d'une vieille cassette qu'un proche, Cypress Grove, a déterré de son grenier. L'enregistrement défectueux empêchait la diffusion mais en revanche les chansons inachevées se prêtaient parfaitement au jeu de la reprise. Du coup, chacun avec des approches différentes, ces trois morceaux, Ramblin' Mind, Constant Waiting et Free To Walk, sont déclinés trois fois, dans des versions assez différentes pour écarter toute lassitude. Le procédé, bien sûr, reste assez contestable, mais le résultat est au-dessus des espérances bien maigres qu'on aurait pu placer dans un projet si branlant. A ces trois chansons s'ajoutent sept autres inédits, tous aussi bons les uns que les autres. Il n'y a strictement aucun déchet. Cela m'étonne d'écrire cette phrase, mais c'est comme ça: l'album est bon de la première à la dernière minute. Nick Cave lui-même, le Goethe de cette compilation, qui - seul petit bémol - fait un peu figure de marbre, ne surpasse en rien ses camarades. A la rigueur, c'est son interprétation, pourtant réussie, qui convainc le moins. Sa voix est majestueuse, mais elle se pose toujours comme une pierre sur du lichen, elle est lourde, épaisse, en cela impressionnante mais certainement moins vibrante que celles de David Eugene Edwards ou de Lydia Lunch.
Cette chicane exceptée, l'ensemble du disque se plait à varier de quelques nuances la position initiale de Jeffrey Lee Pierce, que le béotien parvient à restituer à travers les différents portraits qu'en brossent les invités.
Les Raveonettes, par exemple, sortent du lot constitué par Mark Lanegan, Nick Cave et DDE, tous trois assez proches, en livrant une version réverbérée et pleine de fuzz de Free To Walk qui, du coup, ne ressemble pas du tout aux deux autres avatars de cette chanson. Autre exemple de variantes audacieuses: Constant Waiting par John Dowd, qui martyrise le morceau jusqu'à le faire ressembler à du post-punk - complètement à rebours de la version folk de Mark Lanegan (qui s'est d'ailleurs surpassé).
Ailleurs, tout est bon: les Sadies, dans la veine de New Seasons et des Byrds; Crippled Black Phoenix, le plus indé de tous les groupes présents, qui tend à magnifier le coté épique des chansons, aidé en cela par DEE, identique à lui-même, peut-être parce que dès le départ il a élaboré son style sur des éléments du Gun Club; Mick Harvey, plus classique; et Cypress Grove qui fait flamber le disque: sa version de Ramblin' Mind est sans doute celle qui sera la plus à même de créer l'illusion auprès d'un fan de Jeffrey Lee Pierce. Pour les autres, de toute façon, elle constitue en soi un moment d'interprétation unique. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à s'intéresser à Jeffrey Lee Pierce lui-même.
Moment préféré: Just a Mexican Love, mais chacun sait déjà (ou saura) que j'adore absolument la voix de DEE.