Ces gars n'ont que 5809 amis sur myspace, 5810 avec moi, tout en étant inscrit depuis 2004. Un groupe français amateur peut s'en trouver 1000 de plus avec un peu d'huile de coudes et un bon relationnel. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Que les fans de rock sont moins nombreux par kilomètre carré; que les américains ont perdu leur connexion; ou que War On Drugs est mauvais? Loin de là! Ils comptent en leur sein l'un des singer-songwriters les plus talentueux de la nouvelle génération d'Amérique, le phénoménal Kurt Vile, sorte de Jay Reatard débutant et maintenant embarqué dans une carrière solo qu'on espère aussi prolifique que ses débuts (3 albums en 2 ans), mais surtout, ils ont composé au moins trois superbes morceaux pop-rock hallucinés: Arms like boulders, le plus folk, Taking the farm et ce Needle in your eye 16 que je vous propose en vidéo. En plus c'est bien présenté. Reste à écouter en entier l'album Wagonwheel Blues qui, parait-il, est plombé par deux longs instrumentaux. Eh, non, les gars! Avec un talent pareil, ne nous faîtes pas le coup d'abandonner la pop pour des jams sessions! Parce que Comets On Fire, ça peut impressionner un bon coup, mais ça finit toujours par devenir pénible...
WAGONWHEEL BLUES
War On Drugs
Secretly Canadian, 2008
La chanson de la semaine
lundi 21 décembre 2009
vendredi 18 décembre 2009
Childish Prodigy

Il y a des jours où je suis content d'avoir choisi Matador pour pseudo. C'est un hasard: je ne faisais pas référence à la boîte qui a signé Yo La Tengo et les Ponys mais simplement au torero principal, celui qui sacrifie la bête dans l'arène. Par glissement sémantique, je suis ravi de pouvoir lier Matador au label qui a eu l'heureuse idée de soutenir Kurt Vile, ce "jeune prodige", comme il se désigne lui-même en clin d'œil à un article de presse.
Après un album qui s'intitulait sobrement "le faiseur de hits de Philadelphie", Kurt Vile est donc de retour avec un titre tout aussi présomptueux mais entièrement légitime. Childish Prodigy est avec quelques autres (Girls et Jay Reatard) une des meilleures surprises de l'indie-rock US, depuis... les années 90.
Kurt Vile est mal présenté sur internet. Il écoute les primitifs américains, John Fahey, Mississipi John Hurt, Robert Jonhson, plus récemment Neil Young et pour toutes ces raisons, se trouve hâtivement catalogué americana/folk, alors que son disque est avant tout un concentré de rock dégingandé comme Pavement, flou comme My Bloody Valentine et surtout, un détonnant mélange de blues primitif et de malformation sonore presque noise.
Sur Inside Lookin out, par exemple, vous croyez entendre la sonnerie de la locomotive à vapeur et le bruit approchant de la chaudière, tandis Freak Train reprend le rythme hypnotique des roues. Vous êtes propulsé d'un coup dans une version psyché et alternative du Tennessee des années 20, dans la peau d'un rambler qui prend le wagon en marche.
Eh oui, les bluesmen faisaient la même chose. Mais halte là! Pas de passéisme ici: Kurt Vile a les moyens sonores d'un gars d'aujourd'hui et malgré une production un peu lo-fi peut vous faire passer une guitare pour un ordi. En dehors des super chansons pop comme A monkey (que je rêve d'entendre un jour à la radio... mais pourquoi pas?), ce que j'apprécie chez lui c'est aussi cette volonté de brouiller la perception qu'on a du rock traditionnel (dont il est pourtant friand). Je n'émets de réserve que sur une chanson: overnite religion laisse penser que notre jeune prodige a écouté Animal Collective (non! ne fuyez pas!). Hors-ça, il est parfait.
Mais Childish Prodigy n'est pas seulement une curiosité sonore, c'est surtout le disque d'un chanteur qui a la patate et je crois que c'est ce qui le distingue vraiment du lot: Hunchback, d'entrée de jeu, est ravageur. Entre premier et second degré, affectation et rage, Kurt Vile dynamite l'album et nous emmène bien loin du rock à frange, fun, cool, peut-être, mais redondant, pour nous faire exulter comme jamais depuis... des lustres! Pareil quand il gueule sur Inside Lookin' out, son European Son à lui.
Ce n'est pas que ce soit entièrement nouveau (ni même parfait), mais après une décennie de punk-rock à l'ancienne, jusqu'au fantasme régressif de Jim Jones Revue, qui nous ramène carrément 60 ans en arrière, l'esprit alternatif du rock indé commençait à me manquer. Des groupes de ce genre, il y en a eu dans les marges du revival rock, bien sûr, mais rien de bien affriolant. Rien qui égale cette tour de Pise improbable et azimutée, rien qui soit pourvu d'une atmosphère aussi fraiche. L'effet de surprise ajoute encore à l'émulation que ce disque est susceptible de créer, coiffant tout le monde sur le poteau. C'est vraiment une super nouvelle pour cette fin d'année et, je crois, la première graine semée pour la décennie qui vient. Tenez, puisqu'on parle de classement ces temps-ci, Childish Prodigy est en seconde place, derrière Girls. Voilà, je n'ai pas écouté autant de disques que nombre d'entre vous, mais je sais que ces deux-là, sans comparaison avec d'autres, peut-être meilleurs, peut-être moins bons, qu'en sais-je, il est possible d'y tenir, de s'y accrocher fermement, parce qu'on voit en eux un horizon probable, un germe de quelque chose de durable et de consistant. Et dire que tous ces gars sont influencés par Ariel Pink, il serait peut-être temps que je m'intéresse à cet énergumène-là. Jusqu'alors, je dois dire, inconnu au bataillon.
CHILDISH PRODIGY
Kurt Vile
Matador, 2009
jeudi 17 décembre 2009
TOP QUINZE des chansons de l'année
Sensiblement différent de mon top myspace dans l'ordre des chansons (mais là, je chicane)
15 - Suit on a frame (Joe Henry)
Pas de vidéo pour le moment. Il faut guetter youtube, hélas.
14 - Leap (the Cave Singers)
Eh oui, il ne chante pas très bien, tout est en équilibre fragile.
13 - Ain't nothing like you (Blakroc)
Vous connaissez déjà, je vous avez présentés.
12 - Run Chicken Run (The Felice Brothers)
L'album est moyen, mais cette chanson est très énergique (surtout sur scène, comme en témoigne la vidéo)
11 - Andrew (Crystal Antlers)
Comment ça c'est inaudible?
10 - Tell my mom I miss her so (Ryan Bingham and the Dead Horse)
Je suis affligé par les commentaires des petits GI américains, heureusement ici, il y a des fans d'americana pour relever le niveau.
9 - Mr Mudd and Mr Gold (reprise de T.Van Zandt par Steve et Justin Townes Earle)
On écoute la version du fils Earle, Justin Townes, pour changer un peu.
8 - Hunchback (Kurt Vile)
Découvert il y a très peu de temps. C'est énorme!
7 - Hands (the Dutchess and the Duke)
Quans les albums seront-ils disponibles en France?
6 - Perfection as a hipster (God Help the Girl)
Très mignonne cette Catherine Ireton... Et Neil Hannon, ici, est impeccable.
5 - It ain't gonna save me (Jay Reatard)
Le grand absent des top 2009. L'album est un peu routinier, mais ce morceau est un hit.
4 - Standing between the lovers of Hell (the Warlocks)
La catharsis pure.
3 - Laura (Girls)
N'importe quel morceau de leur album en fait.
2 - Shampoo (Elvis Perkins)
Son meilleur titre. En un an il a dépassé le nombre d'écoutes de la plupart des chansons enregistrées sur mon i-pod depuis plus de deux ans.
1 - The mountain (Heartless Bastards)
ça fait rêver...
15 - Suit on a frame (Joe Henry)
Pas de vidéo pour le moment. Il faut guetter youtube, hélas.
14 - Leap (the Cave Singers)
Eh oui, il ne chante pas très bien, tout est en équilibre fragile.
13 - Ain't nothing like you (Blakroc)
Vous connaissez déjà, je vous avez présentés.
12 - Run Chicken Run (The Felice Brothers)
L'album est moyen, mais cette chanson est très énergique (surtout sur scène, comme en témoigne la vidéo)
11 - Andrew (Crystal Antlers)
Comment ça c'est inaudible?
10 - Tell my mom I miss her so (Ryan Bingham and the Dead Horse)
Je suis affligé par les commentaires des petits GI américains, heureusement ici, il y a des fans d'americana pour relever le niveau.
9 - Mr Mudd and Mr Gold (reprise de T.Van Zandt par Steve et Justin Townes Earle)
On écoute la version du fils Earle, Justin Townes, pour changer un peu.
8 - Hunchback (Kurt Vile)
Découvert il y a très peu de temps. C'est énorme!
7 - Hands (the Dutchess and the Duke)
Quans les albums seront-ils disponibles en France?
6 - Perfection as a hipster (God Help the Girl)
Très mignonne cette Catherine Ireton... Et Neil Hannon, ici, est impeccable.
5 - It ain't gonna save me (Jay Reatard)
Le grand absent des top 2009. L'album est un peu routinier, mais ce morceau est un hit.
4 - Standing between the lovers of Hell (the Warlocks)
La catharsis pure.
3 - Laura (Girls)
N'importe quel morceau de leur album en fait.
2 - Shampoo (Elvis Perkins)
Son meilleur titre. En un an il a dépassé le nombre d'écoutes de la plupart des chansons enregistrées sur mon i-pod depuis plus de deux ans.
1 - The mountain (Heartless Bastards)
ça fait rêver...
mercredi 16 décembre 2009
69 chansons d'amour...

... pour se lasser d'aimer. 69, c'est trop, beaucoup trop. Mais on n'est pas obligé d'écouter le coffret en une fois. Il a eu les yeux plus gros que la tête, assurément, mais Stephen Merritt est un des types les plus originaux du monde indépendant américain. Il n'est jamais en reste d'un projet farfelu et insolite. La dernière fois c'était un disque entièrement consacré aux guitares distordues - un peu foiré d'ailleurs -, un autre dont chaque titre commençait par I... En s'imposant ce style de contrainte, il invite l'oulipo dans sa fabrique et tente de régénérer la pop, en jouant sur les codes et l'inventivité. Pas facile, en effet, de surprendre quand on dit que tout a été fait. Alors peut-être reste-t-il comme solution de créer des règles pour échapper au nivellement général et obtenir un résultat neuf et aléatoire. Savant mélange de contraintes et de hasard.
69 Love Songs, sorti en 2000, est sa grosse oeuvre, l'album de référence cité par les fans. Il n'est pas absolument intouchable, ce n'est pas Pet Sounds ni le White Album, mais la volubilité du projet impressionne. Stephen Merritt s'est entouré de quelques musiciens mais reste néanmoins le maître à bord, il est l'homme orchestre, le touche-à-tout qu'on retrouve aussi bien à la guitare qu'aux claviers, au violon, au xylophone, aux cymbales, au triangle et autres fanfreluches. Même s'il a un groupe, il s'occtroie à juste titre la part du lion dans l'estime publique. Pour certains, c'est un petit maître de la pop music.
Soyons honnêtes: il est plein d'idées, souvent bonnes, mais il a une manière de chanter toujours la même, sans grande réussite mélodique. C'est que Stephen Merrit est à part égale un créateur de mélodies instrumentales et un parolier. La musique prenant beaucoup de place, le sympathique Léonard de Vinci n'arrive pas vraiment à lui imprimer une autre ligne mélodique. Cela n'empêche pas qu'occasionnellement il crée des chansons sublimes, comme All My Little Words. Le reste du temps, c'est vrai, on a surtout affaire à un bricoleur ingénieux et souvent surprenant. La curiosité de l'auditeur est pour beaucoup dans l'affaire.
69 LOVE SONGS
The Magnetic Fields
Domino, 2000
mardi 15 décembre 2009
Jack the Ripper

Cette rétrospective ne suit pas d'ordre défini. Il ne s'agit pour moi que d'écrire un billet sur chacun des albums qui m'ont marqué pendant cette décennie, sans classement, sans ordre de préférence ni échelle d'importance. Je ne sais pas exactement où se situe Jack the Ripper dans ma hiérarchie intime mais ce qui est certain, c'est que de tous les groupes français, il est le seul à avoir atteint dans mon estime un palier d'ordinaire réservé à des groupes étrangers.
Bien sûr, on peut dire que Jack the Ripper est anglophile. Le nom du projet comme la langue choisie par le chanteur ne trompent pas sur les influences du groupe. Mais il faut pourtant préciser, sans chauvinisme aucun, que Jack the Ripper est plus profondément français que bien des chanteurs rabelaisiens. L'esprit de notre pays transparait en effet partout où les arrangements prennent de l'ampleur. Avec leur parure de goguette, les morceaux de Jack the Ripper nous ouvrent les portes d'un cabaret satiné et chatoyant, peut-être plus parisien encore que londonien. On se croirait en fait en pleine période impressionniste.
Invitant piano, mandoline, trompettes, trombone et violons, selon le modèle du collectif plutôt que suivant la formation restreinte du groupe, Jack the Ripper flirte avec cette approche diversifiée qui singularise aussi le Canada. Du coup, c'est à la fois un disque de musiciens mais aussi la preuve éclatante qu'on peut chanter anglais sans trahir ses origines, tandis que d'autres s'évertuent à singer en français, tant bien que mal, des rock'n'roll anglophones inadaptés.
Il reste néanmoins une influence anglaise prédominante dans des morceaux comme Goin' Down: celle, fascinante, du Careful With That Axe Eugene de Pink Floyd, que le chanteur a l'air d'apprécier tout particulièrement. Quiconque a vu la performance du groupe à Pompéï, sur fond d'irruption volcanique, sait que Careful était à l'origine destiné à effrayer le public - qui rigole peut-être un peu, aujourd'hui, avec le recul. Goin' Down fera sourire lui aussi: le chanteur y prend la voix de Golum et navigue sans phare entre premier et second degré. Un coup on se moque gentiment, l'autre on profite de la vertu libératrice du rock, cet exutoire des passions primaires. Entre le délire et la catharsis, Goin' Down réussit le double-jeu.
Il y a quelques années, le groupe avait laissé un long message de présentation sur son myspace, avec une explication de leur concept. S'appeler Jack the Ripper, non en hommage au classique du blues, mais en référence au meurtrier de Whitechapel, c'était plutôt énigmatique. Le propos du groupe était bel et bien tortueux et torturé, mais on comprenait leur volonté de sonder la psyché des hommes, l'intérêt qu'ils prenaient à la difficile maîtrise des passions, entre leur expression sordide et le refoulé qui en fait des bombes à retardement. Il y avait cette inquiétude autour de la folie et, en même temps, ce désir - finalement très politique, très humaniste - de la canaliser par la création.
Il paraît que la peur de devenir fou est l'angoisse prépondérante des êtres humains, selon un sondage dont je n'ai plus les sources. C'est étrange, quand on observe tous les jours des dangers plus imminents. Mais la folie est la conséquence d'une lutte insoutenable: ce qu'elle interroge avant tout c'est notre faiblesse, le point limite où le contrôle que nous gardons sur nos actions et notre vision du monde vacille. Peut-être est-ce cela, surtout, qui fait peur aux gens à travers la folie: la mise à l'épreuve par les aléas de la vie de leur capacité de résistance, la crainte d'être rivé à une impuissance.
Qu'on ait compris ou pas la visée de Jack the Ripper, il reste cet excellent disque, une coudée au-dessus de Yann Tiersen, qui est devenu trop prévisible. En attendant la suite, s'il y a lieu, on pourra faire une incursion dans l'univers des Fitzcarraldo Sessions. Mais c'est une autre histoire, toute récente.
LADIES FIRST
Jack the Ripper
Le Village Vert, 2005
Blueberry Boat

On continue la rétrospective des années 2000 avec un groupe tordu qu'on ne soucie ni d'aimer ni de détester. C'est un groupe qui existe, comme une pierre sur un chemin, et puis c'est tout. Même si cette pierre a une forme étrange et une couleur irrisée, même si elle ne ressemble pas aux autres cailloux et graviers qui pavent l'allée, on la laisse à sa place sans y toucher. De temps en temps, on y jette un oeil, parce qu'on se demande ce qu'elle va devenir, si par hasard elle ne va pas s'élever dans les airs et rejoindre le vaisseau spatial venu la ramener sur Mars. Les Fiery Furnaces, à bien des égards, sont à compter au nombre des quelques aberrations sonores ayant vu le jour dans cette décennie. Je ne parle pas de Coldplay, des Minus 5 ou de Black Eyed Peas. Ces choses sont banales, sans envergure et parfaitement inoffensives, leur existence ne se justifie pas puisque le public s'amasse tout autour comme un banc de moules. Mais les Fiery Furnaces, il faudrait qu'ils s'expliquent. Peu de gens écoutent, peu comprennent et beaucoup se demandent s'il y a quelque chose à comprendre dans ces morceaux à tiroirs qui n'en finissent plus de se décomposer. C'est l'art de la poupée russe: on l'ouvre et il y en a encore une dedans. ça n'en finit pas. On croit devenir fou. C'est peut-être pour ça que certains toqués, comme moi, écoutent ce groupe avec la même curiosité obsessionnelle. Je ne peux pas dire que c'est "typiquement le genre de groupe qui fait ceci ou cela", puisque, précisément, ils sont atypiques.
Je n'ai chez moi que deux albums, Blueberry Boat, celui sur lequel je vais concentrer mon attention, et Bitter Tea, une coquille creuse, le vide enluminé par des bruitages dignes d'un plateau télé ("Incroyable Gérard! Il a gagné une télé à écran plasma, etc"). Le fait qu'il comporte leur plus beau morceau, le très nostalgique Pearl Harbour Blue ne m'empêchera pas de le revendre. Je ne me suis pas farci le disque avec mère-grand, il ne faut pas exagérer non plus. En revanche, leur dernier album semble à première vue renouer avec l'efficacité pop, ce dont je ne leur ferai pas un tort. En fait, le dernier disque des Fiery Furnaces, ce pourrait être l'équivalent de l'art contemporain lorsque celui-ci atteint son classicisme, c'est-à-dire lorsqu'il a trouvé une forme stable et identifiable. A force d'huile de coudes, les Fiery Furnaces commencent peut-être bien à réussir, à trouver leur maturité. En attendant, Bluberry Boat tatonnait, empruntant des routes à droite et à gauche, mais ne mettant jamais, au grand jamais, un pas devant l'autre. Le sommet de ce disque pour lequel le mot foutraque a sans doute été inventé reste Chief Inspector Blancheflower, qui se conclut brusquement sur un solo de guitare tétanisant, pas loin de Crazy Horse. C'est complètement incongru, au vu des minutes qui précèdent. Mais les Fiery Furnaces sont comme ça: ils ont beaucoup d'idées, beaucoup de paragraphes, mais jamais de transition. Trop fatigant sans doute d'être pédagogue, quand on a une pensée en forme d'escalier et qu'on peut sauter d'un plan à l'autre sans liant. Alors, ils balancent tout, peut-être au hasard, peut-être avec un talent incompris. Ils sont frères et soeur et on dit que les frères et soeurs ont leur propre langage. Ce n'est pas le plus universel. Mais on les suit quand même - de loin.
A écouter: Chris Michaels, Paw Paw Tree, Mason City, Chief Inspector Blancheflower, Birdie Brain
BLUEBERRY BOAT
The Fiery Furnaces
Rough Trade, 2004
Je n'ai chez moi que deux albums, Blueberry Boat, celui sur lequel je vais concentrer mon attention, et Bitter Tea, une coquille creuse, le vide enluminé par des bruitages dignes d'un plateau télé ("Incroyable Gérard! Il a gagné une télé à écran plasma, etc"). Le fait qu'il comporte leur plus beau morceau, le très nostalgique Pearl Harbour Blue ne m'empêchera pas de le revendre. Je ne me suis pas farci le disque avec mère-grand, il ne faut pas exagérer non plus. En revanche, leur dernier album semble à première vue renouer avec l'efficacité pop, ce dont je ne leur ferai pas un tort. En fait, le dernier disque des Fiery Furnaces, ce pourrait être l'équivalent de l'art contemporain lorsque celui-ci atteint son classicisme, c'est-à-dire lorsqu'il a trouvé une forme stable et identifiable. A force d'huile de coudes, les Fiery Furnaces commencent peut-être bien à réussir, à trouver leur maturité. En attendant, Bluberry Boat tatonnait, empruntant des routes à droite et à gauche, mais ne mettant jamais, au grand jamais, un pas devant l'autre. Le sommet de ce disque pour lequel le mot foutraque a sans doute été inventé reste Chief Inspector Blancheflower, qui se conclut brusquement sur un solo de guitare tétanisant, pas loin de Crazy Horse. C'est complètement incongru, au vu des minutes qui précèdent. Mais les Fiery Furnaces sont comme ça: ils ont beaucoup d'idées, beaucoup de paragraphes, mais jamais de transition. Trop fatigant sans doute d'être pédagogue, quand on a une pensée en forme d'escalier et qu'on peut sauter d'un plan à l'autre sans liant. Alors, ils balancent tout, peut-être au hasard, peut-être avec un talent incompris. Ils sont frères et soeur et on dit que les frères et soeurs ont leur propre langage. Ce n'est pas le plus universel. Mais on les suit quand même - de loin.
A écouter: Chris Michaels, Paw Paw Tree, Mason City, Chief Inspector Blancheflower, Birdie Brain
BLUEBERRY BOAT
The Fiery Furnaces
Rough Trade, 2004
lundi 14 décembre 2009
120 Days

A l'heure des bilans de fin de décennie qui vont être bourrés de groupes de rock, mais aussi, sur d'autres blogs, de groupes de hip-hop, il n'est pas inutile de revenir sur un accident de parcours. Il y a des ovni bizarres, qui deviennent cultes à force de renverser le jugement commun - le truc préféré des amateurs de la contradiction gratuite - mais aussi des ovni banaux, un peu comme ces photos de sphères lumineuses qui n'étonnent même plus parce que le trucage est grossier. 120 Days est de cette espèce, c'est un disque d'allure commune, non parce que les morceaux ressemblent à du déjà-vu (ce qui est tout de même le cas) mais parce que la production vaguement électronique de l'album est assez clinquante, comme du Kraftwerk grand public. Ils nous viennent de Norvège et sonnent froid comme le pays doit l'être en ce moment même.
Quant aux compos, elles sont assez ambigues... Endoctriné par le retour du rock et l'idéologie punk régnant chez l'intelligentsia du rock (c'est-à-dire le contraire de l'intelligence réel, des jugements lapidaires, un culte naïf de l'authenticité, un vitalisme basique et un positionnement par principe contre la musique de masse), j'ai descendu l'album après l'avoir initialement aimé, il y a de cela plusieurs années. C'est l'une des rares fois où je suis obligé de concéder l'influence contre-productive et aliénante de l'opinion publique sur la mienne. La production est parfois si clinquante que j'ai pris honte. C'est un peu la faute aux musiciens aussi. Ils ont, dans le fond, de vraies bonnes chansons, mais se sont donnés une image de minet ridicule, qui ne colle pas du tout avec la voix du chanteur, capable d'une belle raucité sur Get Away et souvent proche de The Cure. Leur crédo, c'est plus ou moins de faire sonner Spacemen 3 comme U2, avec des éléments de Kraftwerk. C'est vraiment bon, à deux reprises ça atteint même des sommets: Get away donc, que je vous propose d'écouter - parce que vraiment c'est une de ces pépites inconnues dont les bloggeurs raffolent tant - et Come out, come down, fade out, be gone. Le dernier morceau, long de huit minutes, a un final très prenant aussi (I've lost my vision).
Il y a un fossé entre l'image et la musique. C'est un fait rare. Ce disque est passé par la lessiveuse, les musiciens sentent le savon, mais malgré tout c'est un disque de rock. Quant à l'emballage du produit, personnellement il ne me gêne plus - si tant qu'il m'ait un jour gêné autrement que par préjugés.
S/t
120 DAYS
Smalltown Supersound, 2007
http://beemp3.com/download.php?file=448720&song=Get+Away
dimanche 13 décembre 2009
Des chansons en or (6)

On peut avoir plein de bonnes raisons de ne pas aimer celui que la tendresse populaire désigne sous le nom de Boss - un sobriquet que je trouve plus amical encore que révérencieux. En plus, c'est assez fréquent chez les internautes, pour qui sa musique évoque le doux métier de camionneur et les stations fm. Le Boss, c'est une certaine Amérique, une vision de la démocratie, parfois clinquante et un poil populiste dans son apparence, mais finalement assez sympathique. Il est un peu le Victor Hugo du rock. Un poids lourd qui écrase les scrupules des esthètes, un Pantagruel de la compassion qui charrie avec lui, dans son envergure formidable, beaucoup de mauvais goût, mais aussi quelqu'un qui, au détour d'un refrain, peut vous toucher droit au cœur.
Las des grosses guitares, il a enregistré Nebraska comme s'il avait pratiqué l'ascèse. C'est tout le problème des gros coffres : quand ces forces de la nature sont passées par un extrême, elles en viennent brutalement à l'autre. Pour l'auditeur, c'est comme faire une cure sans avoir été malade. Verdict: un peu trop frugal pour ne pas être légèrement ennuyeux. Mais si je ne suis pas fan de Nebraska, c'est aussi, pour ceux qui ont pris l'habitude de me lire, que je n'ai pas traduit toutes les paroles. C'est vrai, j'ai eu la flemme. Or Nebraska est la fresque de l'Amérique des perdants (mention "anglais obligatoire") et s'écoute comme une histoire, celle de l'envers du décors, celle qui défait les clichés de l'american dream.
Pour Atlantic City, j'ai fait exception, parce que dès le départ la musique m'a enthousiasmé. Elle est un peu plus up-tempo que le reste de l'album et aussi un peu moins dylanienne. Je dirais même que sur cet album folk, Atlantic City est presque un morceau pop, dont le refrain s'incruste facilement dans l'esprit: "everything dies, baby, that's a fact". C'est le morceau idéal pour découvrir Bruce Springsteen, bien plus que Born in the USA ou Streets of Philadelphia.
lundi 7 décembre 2009
GIRLS

Je m'aperçois qu'un mois s'est presque écoulé depuis le dernier post. Ce n'est pas que la matière manque. Prenons l'album des Girls. Je veux en parler depuis des semaines. Je pourrais tartiner cent lignes là-dessus. Mais toutes futiles, à coté du sujet ou redondantes. Quand on aime trop un disque, on se contente d'une exclamation. Ce post est donc une exclamation un peu longue, n'ayant pas trop en vue de parler musique.
En effet, l'écoute risque d'être tellement biaisée par les médias qu'il est peut-être judicieux de ne plus en rajouter. Ayant eu la chance de l'écouter sans passer par trop d'intermédiaires, j'ai pu me concentrer sur l'expérience musicale, sans l'associer à cette image de jeunes cancres obsédés par le sexe ni à aux louanges des distributeurs d'opinion. Depuis, l'engouement médiatique (quasi unanime: Pitchfork, Magic, R'n'F, the Guardians...) a entraîné son lot de positionnements contradictoires. Tout ce qui est unanimement médiatisé - encore plus dans un milieu indé qu'on suspecte fortement d'avoir ses petits codes trompeurs, ses propres miroirs aux alouettes - déchaîne les suspicions.
Or, il faut remettre les choses à plat: pour arriver à cet engouement, un groupe ne peut pas se contenter d'une notice d'attaché de presse ou d'un coup de pouce. La plupart des groupes qui sont parvenus à attirer l'attention le doivent à une certaine qualité, même si cette qualité peut n'être que la convenance à la mode. Kings Of Leon, Strokes, Killers, Franz Ferdinand... Je n'aime pas vraiment la moitié d'entre eux, mais ce n'est pas nul non plus. Girls est là, pas loin du sommet de la pyramide indé, et il y est parce qu'il le mérite. Il n'y a pas longtemps, j'écrivais de Joe Henry: "il a l'air crédible parce qu'il l'est". Pareil pour Girls. C'est le groupe qui est susceptible de donner envie de faire de la musique à un jeune de 18 ans. On a pris une guitare parce qu'on a écouté - quoi? Nirvana, les Smashing Pumpkins (références pour Girls)? Oasis? Eh bien, Girls se pose là. Et tout de suite. Avec un album pas parfait du tout, mais super. La perfection est une chose, genre œuvre de salon, l'apanage de Joe Henry par exemple; le disque super en est une autre. C'est ce genre d'album qu'on adopte dès la première écoute, sans même se poser la question à un moment ou à un autre de savoir si c'est vraiment bon, si ce n'est pas, somme toute, la décalque de quelque chose de plus ancien. C'est à l'usure, parce qu'on a éprouvé des sensations indélébiles mais aussi parce que l'accoutumance l'a rendu indispensable, que l'album acquiert sa valeur affective ET esthétique (l'album devient un objet esthétique après coup). Il serait donc trop tôt, si on me suit, pour vanter Girls. J'aurais pu attendre encore un an ou deux avant de laisser une chronique. Mais finir l'année sans avoir mentionné l'existence de ce disque ç'aurait été chicaner sur des détails sans évoquer les grandes lignes!
Pourquoi? Parce que c'est une cohabitation réussie entre l'amateurisme du chant et le professionnalisme d'une mise en son lo-fi par faute de moyens, mais talentueuse par son savoir-faire. Parce que c'est le printemps éternel, une vision musicale du bonheur (moyennant des paroles tristes), un rêve californien et adolescent, avec mélodies, harmonies vocales et rythmes entraînants (Lust for Life, Laura, God Damned). Parce que c'est un rappel des sensations originelles du rock indé, celles qu'on a éprouvées une première fois en écoutant les groupes marquants des nineties (notamment la noise de Morning Light ou le mur du son qui conclut Hellhole Ratrace). Surtout, parce que ce disque est ambigu, comme les meilleurs, louvoyant sans cesse entre le jour et la nuit, la joyeuse pop estivale nuancée par des paroles crues (Laura), le rock vite envoyé (Big Bad Mean Motherfucker) et la tristesse d'une complainte (Lauren Marie). C'est vraiment très bon et, tout jeunisme à part, on se demande si on n'aurait pas dû avoir 18 ans à sa sortie. En tout cas, une fois qu'on l'a, on n'a plus besoin de disques avant longtemps. Et ça, c'est très rare.
samedi 14 novembre 2009
Bosque Brown

Le voici, enfin disponible par chez moi, cet album tant attendu. C'est une déception, mais il est là quand même, imparfait et bancal. Les journaux vont-ils en faire tout un foin? Je pense au succès d'Alela Diane, à celui de Joanna Newsom... A ce prix, on peut bien chanter les louanges de Bosque Brown. Mara Lee Miller vaut bien les susdites chanteuses. Néanmoins, Baby n'est pas un chef d'oeuvre. C'est comme ça, les gens qui s'occupent de son myspace ne sont pas bêtes, ils ont mis en exergue les deux meilleurs morceaux de l'album, le terrible "went walking" et "the train". Là, on se sent plus près de la chaleureuse Karen Dalton que de l'excentricité pénible de Joanna Newsom. Le temps d'une mesure ou deux, Mara Lee Miller frôle le grand frisson. On se demande si ce n'était pas de l'impro. D'ailleurs le disque est claudiquant, les structures sont minimes et le chant divague souvent. Trop, sans doute. Même Went Walking, à y regarder de plus près, souffre d'un excès de maniérisme. La façon de traîner les mots, de les expirer (quand elle chante "sky" par exemple), c'est irritant. Presque gêné, je n'écoute le disque que pour en parler à vrai dire. Ce n'est pas qu'il soit mauvais, mais en matière de chant, j'ai tiens sans doute à mes canons. Il est probable que je ne sois pas seul à le penser, même si pour le moment l'album rencontre un succès critique - que je ne juge pas immérité ou injuste, mais simplement un peu surfait. Il se trouve qu'à force de forcer l'intensité, on finit par douter d'elle.
mercredi 11 novembre 2009
Blakroc (ils arrivent!)

Ne manquer ça sous aucun prétexte. Le 27 novembre sort le disque du projet rap (oui, RAP) du duo d'Akron (Ohio), les puristes Black Keys. Généralement écoutés par des puristes du blues-rock (qui n'est pourtant pas un genre de puriste), les Black Keys ont rêvé d'un truc de fou, réunir les deux cultures presque ennemies, rock (réputé pour être devenu le genre dominant de la bourgeoisie blanche) et le rap (la musique des zonards, souvent reléguée dans les bas-fonds d'où elle vient, puisque subsistent les inévitables préjugés de classe - en même temps, d'autres rappeurs aux USA, tout sulfureux qu'ils soient, roulent en décapotable et font étalage de leur richesse...). Ainsi, pour chaque chanson, les Black Keys ont réalisé la musique tandis que des invités rap déversent leur flow en rythme. L'album est attendu avec impatience par beaucoup de gens, à cause des premiers extraits (surpuissants) et du trailer (surpuissant aussi).
Dan Auerbach et Patric Carney se sont sans doute levés un jour avec une idée fixe: "I had a dream" - c'est que les Black Keys soient plus énormes que les White Stripes. Cela peut vous sembler gros (à eux aussi peut-être, car somme toute je prête des intentions démesurées à un groupe modeste), le fait est que désormais ils ont les moyens de leurs ambitions (et s'ils n'en avaient aucune, ils peuvent maintenant en avoir). En tout cas, si c'est déjà un plaisir de voir une cloison s'abattre, ce qu'il y a de mieux c'est que le duo blues-rock a fui l'inanité des déclarations de principes, ces généreux croisements de laboratoire qui mènent à l'impasse. Blakroc n'est pas un simple concept d'hybridation musicale: c'est une réussite empirique. Bien sûr, je n'ai pas écouté l'album entier, mais seulement trois chansons. Trop peu pour savoir si sur la longueur, il n'y a pas quelques redites, mais assez pour sentir trois coups de canon dans la vitrine - qui vole en éclat. Voici le premier extrait officiel. Le fait que j'aimerais avoir la chemise de Dan Auerbach n'est qu'une considération futile. La musique, le flow, le clip, c'est du sérieux: lourd, puissant, compact. Pour ceux qui en veulent plus, sachez qu'on peut trouver les vidéos du making-of, semaine après semaine.
mardi 10 novembre 2009
Des hymnes?
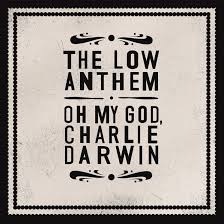
Si j'en juge par le courrier des lecteurs de Mojo et d'Uncut, ce disque a trouvé un public outre-manche - à raison d'une occurrence dans chaque journal, peut-on appeler ça le prélude au succès? Le folk a bonne mine en tout cas. Fleet Foxes l'an passé, cette année Low Anthem? Ce n'est peut-être pas systématique quand même. Comme les barbus de Seattle, ce trio séduit et ennuie en même temps. Il a la particularité - rare! - de réunir deux publics différents: les fans de rock sale et les fans de folk efféminé. On passe sans prévenir d'une chanson typée Bon Iver à un morceau de Tom Waits interprété avec le côté casse-cou de Bruce Springsteen. La cohérence dans tout ça? Peu importe, ceux qu'exaspèrent le folk éthéré pourront se réjouir d'avoir trois titres costauds à se fourrer dans les oreilles: The Horizon is a Beltway, Home I'll Never Be et l'excellent Champion Angel. Avec ça, ils ont un ep fort recommandable. Mais l'autre visage du disque a néanmoins ses qualités. To Ohio, par exemple, n'est pas déplaisant. Cage the Songbird a de bons couplets, avec une voix proche de celle d'Alan Sparhawk. Ce qui étonne, c'est de savoir que le même chanteur est toujours au micro alors que musicalement il joue à saute-mouton. Bon disque dans l'ensemble. Et puis, quand ça ne va pas, il y a toujours un peu d'harmonica pour rendre sympathique. Ils n'ont pas à rougir; un groupe amateur sortirait cet album, il ferait grand bruit. Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à constater l'engouement des médias - même si celui du public aura plus de mal, je le pressens, à suivre.
OH MY GOD, CHARLIE DARWIN
The Low Anthem
Bella Union, 2009
mercredi 4 novembre 2009
Seven Songs Shaping My Fall

Sept, nombre favori des superstitieux, moins ambigu que le treize et plus pratique pour une playlist rapide. Je joue le jeu, proposé par Thanu, du blog There's Always Someone Cooler Than You (ce qui est vrai). Le principe est simple: lister 7 chansons que vous écoutez beaucoup en ce moment. Pour plus de détails, voici l'intitulé exact:
List seven songs you are into right now. No matter what the genre, whether they have words, or even if they’re not any good, but they must be songs you’re really enjoying now, shaping your life. Post these instructions in your blog along with your 7 songs. Then tag 7 other people to see what they’re listening to.
Idéalement, je souhaitais proposer un lecteur regroupant les chansons mais l'une d'entre elle n'était pas présente dans la version désirée.
1 - Wedding Bell (Beach House)
Dans la suite logique de ce que j'écrivais récemment, voici le premier très beau morceau du très bel album de Beach House, Devotion. Vous comprendrez mieux pourquoi ma chronique était très métaphorique. C'est indescriptible.
2 - Tell My Mom I Miss Her So (Ryan Bingham)
Même si je n'aime pas autant son deuxième album, cette chanson, qui en est extraite, est pour moi l'une de ses meilleures, juste derrière Southside of Heaven.
3 - Anyway That You Want Me (Spiritualized)
Puisque je l'ai choisie pour figurer dans la section chansons en or (qui ne sont pour le moment qu'au nombre de cinq), vous vous en ferez vous-même une idée.
4 - Travelling Man (Bert Jansch)
Une bien vieille chanson (1973), remasterisée récemment pour la réédition de L.A.Turnaround. Aussi belle que, à tout hasard, Needle of death. Mais après avoir vu la vidéo de l'enregistrement en studio, celle-ci s'est attirée mes faveurs.
5 - Hellhole Ratrace (Girls)
Deux branleurs de première, avec pour obsession vraissemblable les filles, la gnole, les filles et un peu la gnole. D'habitude, ça m'indiffère. Mais ayant grandi dans les années 90, je me sens en territoire connu avec eux. Leur son me plaît beaucoup et, au-delà, mine de rien, il y a de la mélodie.
6 - More News From Nowhere (Nick Cave and the Bad Seeds)
Depuis trente ans, et après des débuts post-punk dont je suis moins friand, Nick Cave est toujours un caïd. Je fais partie de la proportion d'amateurs qui préfèrent justement des morceaux comme celui-ci à From Her to Eternity. Et il faut visionner le clip, c'est très bien fait.
7 - Catch the Wind (Donovan)
La voici la dernière, celle que je n'ai pas voulu faire écouter. Entendons-nous bien: la version single, celle qui fait deux minutes et quelques, est selon moi très moyenne. En plus, il essaie de chanter comme Dylan, alors qu'il a la chance d'avoir une voix très pure. Préférez la version de 5 minutes, celle des bonus de Hurdy Gurdy Man; le final est somptueux. On y entend de la batterie, de la passion et des envolées vocales.
Découvrez la playlist seven songs shaping my fall avec Spiritualized
Sont invités à poursuivre la chaîne:
hanskilledwildcat
the music rainbow
la musique à papa
le choix de Mlle Eddie
musique-indie
windingtree
homesick in paradise
Libellés :
Beach House,
des chansons en or,
Donovan,
dreampop,
folk anglais,
Girls,
Indie-rock,
Nick Cave,
noise,
planant,
Ryan Bingham,
seventies,
sixties,
Spiritualized,
sunshine-pop
mardi 3 novembre 2009
Prêts?
Voilà, les groupes et artistes sont listés, dans l'ordre alphabétique pour que ce soit plus facile de s'y retrouver. J'ai ajouté en dernière intention Jay Reatard et Kasabian, que j'avais oubliés. Ils sont en fin de liste. Les autres oublis ne sont à mentionner que si vous le jugez utiles, c'est-à-dire si j'ai oublié un de vos artistes préférés. Vous êtes de toute façon invités à déposer et commenter votre liste personnelle ici-même au cas où le principe du sondage anonyme vous semblerait peu intéressant. Je ne doute pas des déceptions du côté des lecteurs qui aiment le folk-rock, l'americana et l'alt-country. C'est normal, cette liste est plutôt généraliste et les genres sont représentés en fonction de leur visibilité dans les médias rock (il s'agit donc tout d'abord de choisir entre ce que les médias ont chroniqué). C'est surtout pour cette raison que j'ai proposé d'ouvrir les commentaires aux listes personnelles, chacun pourra mettre en avant la perle rare.
C'est dit, maintenant vous pouvez y aller, pas besoin d'attendre le 31 au soir pour savoir ce qui, en 10 ans, vous aura marqué.
C'est dit, maintenant vous pouvez y aller, pas besoin d'attendre le 31 au soir pour savoir ce qui, en 10 ans, vous aura marqué.
jeudi 29 octobre 2009
The end of the decade... SONDAGE!

La dernière fois que j'ai proposé un sondage sur ce blog, cela s'est conclu par un échec. Pour ce qui est du nombre de votants, pas de problèmes. Même si ce n'était pas la pagaille, j'en ai dénombré à peu près 35, voire 40. Ce n'est pas le vote de la levée du blocage en AG étudiante, mais ça se défend. Par contre, j'avais omis beaucoup de groupes/artistes importants. Il faut dire que j'avais vu large: ratisser toute l'Amérique des sixties à nos jours. Alors forcément on en oublie.
Mais le problème vient surtout d'un moment de distraction: j'ai effacé les résultats de ma page en pensant sans doute les retrouver ailleurs, toujours est-il que j'ai tout perdu.
Je serai plus sérieux cette fois-ci. Mais là encore, je me propose un objectif démesuré: mettre en concurrence tous les artistes marquants de la décennie! Malgré ma bonne volonté, je ne peux qu'en oublier. Aussi je vais lancer une alternative: pour ceux qui trouvent leurs artistes favoris dans la liste ou qui aiment la visibilité immédiate des sondages, rdv en bas de page (très bientôt). Pour les autres, ceux que le clavier démange, je les laisse déposer leurs coups de cœur en commentaire. N'hésitez pas à vous étaler. C'est avec plaisir que les messages seront lus et laissés à la vue des visiteurs. Pour moi, je me réserve le temps de réfléchir.
lundi 26 octobre 2009
des chansons en or (5)

Il fallait bien que ça tombe sur eux tantôt. Après avoir posté mon billet sur Spacemen 3, ni une ni deux, je me suis plongé dans l'œuvre de Jason Pierce. On peut employer le mot "œuvre" car c'est, de toute évidence, le fruit d'un long travail de studio, d'une gestation obsessionnelle et interminable qui devait idéalement mener au Graal psychédélique. Nul doute que Spaceman soit aussi hypnotisé que son public par le matériau sonore qu'il a travaillé et retravaillé à l'extrême pendant toute sa carrière. Patiemment, il a tissé sa toile autour du même thème qui pourrait se résumer ainsi: "I want to take the pain away".
Sa musique y parvient à merveille. Plus conceptuelle que spontanée, elle tient dans un assemblage de sons et d'instruments, stratifiés au maximum pour rendre une impression puissante et compacte de densité. Anyway That You Want Me est à ce titre une pièce d'architecture, alambiquée et titanesque. Le refrain prend l'auditeur au dépourvu. On croyait écouter de la musique planante et on se retrouve au résultat avec un hymne pop comme les Stone Roses en faisaient à la même époque, pédale wah-wah à l'appui. Mais c'est la fin du morceau, dans la version album, qui estomaque définitivement le fan de musique psyché. Anyway That You Want Me se conclut en effet par une mosaïque sonore chatoyante, où l'oreille s'amuse à entendre danser tous les instruments. Le fiddle qui valse d'un côté, la pédale wah-wah qui pointe, comme une fouine, de l'autre. Cela dure deux minutes et c'est encore trop peu. Le doigt reste à mi-distance de la touche repeat, prêt à repasser les quelques secondes dont on n'a pas assez profité. Alors que des progressifs essayaient de mêler l'orchestre au rock, Jason Pierce a réussi à créer sa propre symphonie sans recours aux méthodes classiques, avec des moyens uniquement modernes. Certains diront que le Velvet Underground faisait plus ou moins la même chose lorsque John Cale délirait sur les fins de morceaux, comme European Son. Mais non, chez Jason Pierce tout est bien ordonné. On imagine plutôt un monstre du studio, un peu à l'image de Brian Wilson ou du leader de My Bloody Valentine. Un type qui a dosé chaque son, qui a assemblé lui-même un puzzle de 1500 pièces, sans rien laisser au hasard, mais tout en donnant l'impression que les instruments jouent pour eux même, en roue libre. Magistral!
ANYWAY THAT YOU WANT ME, 1990
Spiritualized, in Complete Works vol.1, 2003
samedi 24 octobre 2009
Beach House, les vagues sont tristes

Trois disques résument idéalement la vie d'un garçon de plage: Pet Sounds des Beach Boys, pour l'après-midi, The Wolfking of LA, de John Phillips, pour le coucher du soleil, et enfin, Devotion, de Beach House, lorsque la nuit est tombée. Le premier rayonne de l'enjouement des plaisanciers, le second accompagne le marcheur solitaire le long de la plage, au crépuscule, le troisième achève de le plonger dans la nuit. Devotion est comme un rêve habité par l'absence d'un être cher, ou encore un visage incertain de son émotion, figé entre le sourire et la tristesse. C'est un disque parfois douloureux à l'écoute - mais aussi l'un des plus beaux, ce qui arrive parfois de paire.
Je ne sais pas exactement ce qui incite à découvrir Beach House, au-delà d'une écoute timide et décevante sur youtube. Le bouche à oreille y est pour quelque chose, mais peut-être aussi les chansons font-elles insidieusement leur effet, tranquille et durable, pas assez pour emballer du premier coup, mais suffisamment pour tenter d'y revenir, avec la même curiosité insatisfaite. Le bien qu'en pensent les gens de Mgmt m'a, au passage, définitivement résolu. On peut jaser sur l'innovante vulgarité de leur concept, mais leurs influences, quant à elles, sont non seulement propres mais rares. Citer Let It Flow (Spiritualized) comme chanson préférée, c'est me tendre la main. J'ai donc décidé d'écouter en entier, pour de vrai, un album de Beach House. Je l'ai même acheté.
Tout d'abord, je peux confirmer que les premières impressions n'ont rien de renversant. Mais Devotion n'est pas un disque à écouter nécessairement d'une oreille attentive. Il appartient à cette catégorie précieuse des albums qui vous prennent par surprise et changent votre vie sans fracas. Vous ne saviez pas pourquoi vous l'achetiez, vous ne saviez pas pourquoi, exactement, vous vouliez en savoir plus sur ses créateurs. Et pourtant, il est dans votre tourne-disque et il vous enchante. Vous prenez conscience, au fil des morceaux, de sentir quelque chose se creuser en vous, une résistance fondre. C'est un sentiment que vous n'aviez pas éprouvé depuis longtemps, peut-être depuis l'adolescence: celui d'une tristesse non motivée, totalement décalée par rapport aux choses concrètes qui vous entourent. Le monde vient de passer dans un trou d'air...
Ces bizarres sélénites ont l'art de créer des mélodies étranges, lunaires et floutées, qui recèlent pourtant en leur fond un je-ne-sais-quoi de joyeux, comme une rumeur lointaine de Beach Boys voguant sur l'horizon. Si enfant, vous vous amusiez à porter les coquillages à votre oreille pour y entendre la mer, Beach House est à coup sûr le havre de paix où vous souhaiterez bientôt vous reposer.
Victoria Legrand et Alex Scaly sont sans doute des gens bizarres, un peu tristes et en même temps facétieux. On pense à des artisans discrets qui propagent un savoir-faire inédit, hors-temps et indifférent au reste du monde. C'est un peu comme si deux dresseurs de marionnettes, doux dingues itinérants, nous conviaient à leur ballet nocturne, plein de curiosités, de vaguelettes mélodiques qui vous lèchent gentiment les pieds en passant, de valses tristes et bleutées. Ou encore deux souffleurs de verre aguerris, occupés à la fabrication d'une bulle parfaitement ronde et miroitante. Vous les observez faire, bluffés, avec le sentiment fugace que ce n'est pas plus vain qu'écrire un chef d'oeuvre.
Complètement abandonné à son charme, l'auditeur repasse en boucle ce bouquet de chansons pourtant trop uni. Il n'y a pas variété de couleurs, mais une teinte si nuancée qu'elle offre au regard mille effets moirés, mille miroitements insaisissables. La seule chose qui doit vous mettre en garde contre ce disque, c'est l'impression douloureusement triste qu'il laisse parfois sur l'esprit. Influençable ou pas, on ne garde pas intactes nos humeurs quand on écoute un disque aussi impressif.
DEVOTION
Beach House
Bella Union, 2008
lundi 12 octobre 2009
Yonder is the clock

 A dire vrai, j'écris ce billet surtout pour vous faire profiter de cette belle affiche des Felice Brothers, le genre d'affiche qu'un fan se devrait d'épingler au mur et qui habillerait élégamment les cloisons un peu tristes de ma pièce, si j'avais de quoi l'imprimer en grand format. J'en profite aussi pour vous parler de leur dernier album, qui est sorti depuis un moment déjà: Yonder is the clock. Titre extrait d'un roman de Mark Twain, selon mes sources, ce que vous vous empresserez de vérifier si vous êtes familier de leur univers culturel. Pour ce qui me concerne, je garde de Mark Twain un souvenir plutôt mitigé (mais le collège est loin...) tandis que le disque des Felice Brothers, sans être parfait, tient bien sa place dans mon estime.
A dire vrai, j'écris ce billet surtout pour vous faire profiter de cette belle affiche des Felice Brothers, le genre d'affiche qu'un fan se devrait d'épingler au mur et qui habillerait élégamment les cloisons un peu tristes de ma pièce, si j'avais de quoi l'imprimer en grand format. J'en profite aussi pour vous parler de leur dernier album, qui est sorti depuis un moment déjà: Yonder is the clock. Titre extrait d'un roman de Mark Twain, selon mes sources, ce que vous vous empresserez de vérifier si vous êtes familier de leur univers culturel. Pour ce qui me concerne, je garde de Mark Twain un souvenir plutôt mitigé (mais le collège est loin...) tandis que le disque des Felice Brothers, sans être parfait, tient bien sa place dans mon estime.Ce groupe, dont j'ai déjà parlé (voir Frankie's Gun) est, à en croire les commentaires et les vidéos laissées sur youtube, une bête de scène. Chose qui ne se vérifie évidemment pas sur disque, sans compter que beaucoup de titres ici présents sont calmes comme un jour d'hiver - ceci en dépit du fait que la voix (de canard = Bob Dylan) est plutôt chaleureuse, tout comme l'instrumentation folk-rock du groupe. Deux chansons se distinguent nettement du lot par leur entrain et leur prodigalité: Memphis Flu et, surtout, l'imparrable Run Chicken Run, LE moment fort du disque, avec l'intro à l'accordéon, si typique du groupe. La vidéo, capturée live, vaut le pesant d'or. Observez notamment le violoniste, Greg Farley.
L'un des frères Felice, Simone, vient de sortir un disque avec un autre groupe: the Duke and the King (Nothing Gold Can Stay). Suivez le lien, ça a l'air bien aussi. Hélas, jetez un oeil sur les dates de concert... Pourquoi l'Allemagne et pas nous?
YONDER IS THE CLOCK
The Felice Brothers,
Team Love, 2009
samedi 10 octobre 2009
C'était donc vrai?
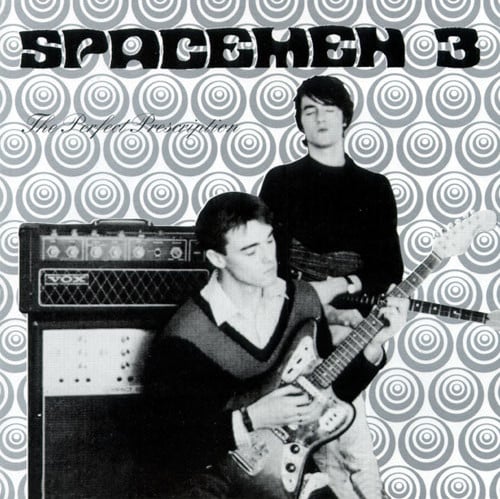
Aujourd'hui, j'ai vu une chose que je n'avais encore jamais vue. Dans les rayons d'un grand magasin multimédia, je suis tombé nez à nez avec un disque de Spacemen 3. Improbable...
ça existe donc vraiment? Ce n'était pas une légende? Mazette! J'aurais peut-être dû sauter sur l'occasion. Mais j'étais trop impressionné pour l'acheter comme un vulgaire objet de consommation. Un choix pareil, ça se médite.
Le hasard veut aussi que je parte en Angleterre la semaine prochaine. Puisque j'en ai trouvé un exemplaire en France, n'ai-je pas une petite chance d'en dénicher un dans son pays d'origine?
Spacemen 3 est un groupe culte. Vraiment culte, c'est-à-dire méconnu et jamais classé dans les rayonnages. Mais Jason "Spaceman" Pierce, après s'en être échappé, a fondé Spiritualized, dans le même genre d'ailleurs, mais plus éclaté, plus éclectique, qui a trouvé une plus large audience. Souvenez-vous, Ladies and Gentlemen we are floating in space, 1997, meilleur album de l'année selon le magazine Q (devant Ok Computer!) et petit succès public. C'était lui, c'était Spacemen 3 rénové, avec un mix de blues, de gospel, de musique planante, de rock noise, etc. Depuis, ce n'est plus tellement ça. Le dernier album, sorti l'an passé, n'a pas fait couler beaucoup d'encre. Mais dans le même temps, on nous parle toujours d'un revival noise (qui leur doit peut-être à eux aussi, et pas seulement à My Bloody Valentine, non?) et par ailleurs la musique psyché est très tenace aux USA (Black Angels, Mgmt) Donc, pas de raison de bouder Spacemen 3. Si les compteurs sont bons, c'est même le moment idéal pour exhiber cette légende underground.
L'album que j'ai eu entre les mains (the perfect prescription) pendant quelques minutes ressemblaient à une réédition (la pochette en carton ne ment pas). On va donc avoir, peut-être, plein de petits nouveaux dans la discothèque d'ici peu de temps. Wait and see...
Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas Jason Pierce qui chante sur ce morceau mais, selon toute vraissemblance, Sonic Boom, le deuxième membre à s'être affublé d'un drôle de pseudo.
mercredi 7 octobre 2009
Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas anglais?

L'anglophilie. Une maladie française, pandémique. Je précise que la promotion quasi exclusive de la musique américaine sur ce blog est également une pathologie, relativement handicapante quand on vit à quelques brassées de l'île des Beatles, mais à une trop grande distance du continent dit "instinctivement réactionnaire". Notez, il y a une scène folk à Lille. Les choses vont bon train. Moi qui croyais qu'ici il n'y avait que des métalleux (proximité de la frontière belge oblige) et des ska-punk bien encombré de leurs heineken... Ici, c'est l'Angleterre des Flandres. Paysage gris, industriel. Et après on s'étonne de l'influence de la musique anglaise. Il n'y a pas que la distance qui fait.
Je m'étais un peu énervé récemment, dans un article. Substantiellement, je disais que la personne qui écrit ce billet n'a pas beaucoup de sympathie pour le rock anglais en général et encore moins pour le mélange ska et rock qui a déferlé dans le pays circa 80.
"Heureux ceux qui vivent dans des zones épargnées où, selon toute vraisemblance, on ne rencontre pas à chaque coin de rue des fans des Clash et de ska-punk. Ici, dans le Nord de la France, c'est une invasion barbare. J'ai l'impression de vivre chez les Huns et les Ostrogoths. Et ma foi, c'est un peu ça. Je ne veux pas dire que c'est forcément mieux ailleurs, mais la proximité avec la Grande-Bretagne entraîne des réactions de rejet que je ne contrôle pas toujours".
Pourtant, à y regarder de plus près, je me suis un peu fourvoyé. Bien sûr qu'il y a des groupes anglais que j'aime! Et, pour me racheter, je me suis dit que je devrais les énumérer.
1° Les Beatles 2°John Lennon 3° Paul McCartney 4°George Harrison 5°...Ringo Star. Non, je déconne. Pour le dernier du moins.

En vérité, c'est plus compliqué.
Tout d'abord, une personne vraiment éclectique n'a que faire des genres, étiquettes trop commodes pour être véridiques, trop cloisonnées pour les esprits larges. Je recommande moi-même l'éclectisme, ne serait-ce que pour l'hygiène mentale. Savoir apprécier tout ce qui vient à soi, sans distinction autre que le potentiel, la qualité, c'est avoir fait un pas de géant vers le contentement intérieur. Mais bon, on n'en est pas tous là. Et comme je cherche dans la musique à creuser un petit sillon qui me fascine depuis bien longtemps, je me tourne, non vers des artistes, mais vers le nom générique qui trace le sillon avec moi. Les artistes sèment le blé, un par un, mais aucun n'est finalement aussi remarquable que le blé qu'il a fait germer et aucun blé n'a à lui seul la qualité d'ensemble du champ. Voilà pourquoi ma première réflexion m'amène à aborder un genre. Une vue large, un panorama, un amour pour la sériation plus que pour l'unité, voilà à peu près ce qui définit l'état moral d'un critique, même amateur. S'il y en a ici, ils confirmeront surement ce point.
Le premier genre qui me vient à l'esprit, le folk-rock pour faire simple, n'a pas en Angleterre la popularité qu'il connaît outre-Atlantique. Le seul motif qui me rende cette lacune intelligible serait la concentration de la population dans un espace restreint, par rapport aux USA encore partiellement dépeuplés.
La mythologie des grands espaces colore en effet cette musique d'un feeling particulier. Elle a infusé jusque dans l'esprit des citadins des grandes mégalopoles: Damien Jurado, de là où il est, Seattle, parle pour les gens du Texas. Et c'est pourtant à une grande distance. Comme si les Anglais parlaient pour... les suisses? On peut supposer qu'il n'y a pas en Angleterre ce sentiment des distances. Le leader des Byrds, R.McGuinn, disait qu'il avait apporté à la pop anglaise le sens de l'espace et de la lumière propre à l'Amérique. Magnifique. En quelques mots, le propos est résumé.
Il y a pourtant en Angleterre des groupes folk-rock. Tout d'abord, peu nombreux, ceux qui s'inspirent ouvertement des ricains, comme El Goodo, qui a piqué son nom à un titre de Big Star. Les Wave Pictures, sur leur dernier disque, ne sont pas toujours loin de la country. Et les Stones ont eu leur période américaine (d'ailleurs très riche). Sans oublier l'inévitable "house of the rising sun" des Animals.
Mais il y a aussi le folk-rock purement anglais, comme celui de Fairport Convention, un de mes groupes préférés. Richard Thompson est peut-être allé trop loin dans l'approche folklorique, mais en faisant remonter à la lumière les racines irlandaises, il a permis de renouer des liens entre la tradition celtique et la chanson pop qui y prenait, sans trop le montrer, ses sources. La country elle-même vient de là, et les américains sont souvent les premiers à le rappeler et à rendre hommage au Royaume-Uni. Pourquoi si peu de folk-rock anglais alors? Pourquoi les Byrds ont-ils semé plus que Fairport Convention?

En fait, il y a un défaut de popularité. Des chanteuses folk anglaises par exemple, il y en a eu beaucoup. Vashti Bunyan, Sandy Denny, la chanteuse du groupe Tree, celle de Pentangle... Mais honnêtement, la plupart ne sont plus écoutables aujourd'hui. Le mouvement folk anglais des années 60 a laissé bien des noms sur le carreau, la faute à trop de maniérisme. Très peu de musiciens/chanteurs sont restés: Donovan, dont je parlais hier, Bert Jansch, John Renbourn, Richard Thompson, Sandy Denny... Citons encore Van Morrison, le plus important. On peut ajouter Kevin Coyne, vraiment méconnu. Plus tard, on a eu Billy Brag et Holly Gollightly. Mais ça ne sera jamais aussi impressionnant qu'une longue liste d'artistes folk-rock americains, au premier rang desquels Dylan, Neil Young, etc.
Pour clore le chapitre folk-rock, j'ajoute que je suis preneur si vous avez la moindre suggestion à me faire, et notamment parmi les contemporains. Je serais curieux de voir à quoi ressemble la scène folk en Angleterre en cette fin de décennie.
Maintenant, considérons un autre genre: l'indie-rock. J'ai écouté les Pixies, j'ai une curiosité pour Pavement, j'ai grandi avec Nirvana (et les Smashing Pumpkins j'avoue). J'aime Yo La Tengo, le BJM, les Warlocks, Galaxie 500, etc. Et là, je me prends une claque en croyant que tout cela dérive uniformément d'influences américaines alors que... si les Pixies ou Pavement sont indéniablement américains dans leur approche du son, le BJM ou Galaxie 500 viennent en droite ligne de Spacemen 3, de Jason Pierce qui, contre toute vraisemblance, est anglais.

Incompréhension: comment se fait-il que pendant toute une décennie celui qui a été l'un des meilleurs compositeurs anglais ait engendré exclusivement de l'autre côté de l'Atlantique tandis qu'aucun groupe british, à ma connaissance, n'a revendiqué la moindre filiation avec Spiritualized ou Spacemen 3, ni même du goût pour ce genre de musique? Méconnu dans son propre pays? Très sérieusement, le peu d'influences de groupes comme Spacemen 3 ou My Bloody Valentine dans l'Angleterre des dernières années laisse songeur. A croire que tout le monde était absorbé par les sixties revisited... A moins que Jason Pierce ne soit lui-même une exception au RU. Et c'est fort possible quand on mesure cet étrange mélange de rock, de blues, de gospel...
Le blues. Venons-y. On ne peut pas dire que l'Angleterre n'ait pas eu son moment blues. Au contraire. C'est écrit dans le cahier des charges. Cream, Clapton, John Mayall, beaucoup plus tard Mark Knopfler. Rien de méchant en fait. Mais ce cas d'école est révolu. Entend-on encore parler de blues-rock? Le blues-rock d'aujourd'hui, ce sont les Black Keys, Radio Moscow et les White Stripes qui s'en chargent. Ah...il y a quand même les Kills... non, ils sont à moitié américains.

La nouvelle génération rock est en fait ce qui a cassé la baraque ces dernières années. Comme le punk-rock (Clash, Sex Pistols), comme le post-punk (Wire, P.I.L), la new-wave (Echo and the Bunnymen, Joy Division, the Cure), le brit-rock (Oasis, Blur, Suede, Pulp), c'est au tour du rock nouvelle génération (à défaut d'un autre nom) de se faire une place dans l'inconscient collectif des hommes d'aujourd'hui. Libertines, Cribs, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Rakes, Art Brut, Horrors, Futureheads, je ne vais pas tous les citer, mais ils sont nombreux à avoir recueilli un peu ou beaucoup de succès ces dernières années. Alors, bien sûr, certains sont très bons, et donc respectables. Qui pourrait prétendre que les Libertines furent nuls? Mais ce n'est pas la source où je m'abreuve, j'ai de l'estime pour eux sans avoir de goût. Par conséquent, quand je vais du coté des anglais, je cherche ce qui est en marge, la seconde zone, mineure mais plus adaptée à mes inclinations. Le graal de poche en somme. Ce n'est pas un fait exprès, mais une conséquence collatérale du succès de ce type de musique dominant.
Mais alors... que resterait-il à l'Angleterre si jamais elle voulait me séduire, m'absorber dans sa masse? Il y a bien quelque chose. C'est la dernière ressource. Un truc qui lui appartient en propre, jamais imité ailleurs. La particularité anglaise. Le pudding? Non, la pop. La pop vraiment pop, consensuelle mais subtile, à deux doigts de la variété mais gracieuse dans son équilibre fragile. Tout d'abord, il y a les Beatles, mais ça on le sait déjà. Je ne parlerai pas des Bee Gees, là c'est trop, trop de chantilly. Les Kinks sont bons, mais il faut les prendre quand ils ne sont pas trop ironiques, pas trop décalés. Ils peuvent être effroyablement british, genre cup of tea et Oscar Wilde. A Well respected man néanmoins ne tardera pas à figurer dans ma liste des chansons en or. Mais ce ne sont pas ces groupes qui font l'objet de mon intérêt. En fait, il y en a trois en particulier. D'abord, Prefab Sprout - et encore, seulement pour un album (Steve McQueen), mais quel album! A supposer même que ce disque fût une exception, une plante rarissime et exotique, je trouverais encore le moyen de croire qu'il résume l'Angleterre, qu'il est à lui seul l'Angleterre. Quiconque a écouté Goodbye Lucille peut-il me contredire? Et qu'il soit proche de la variété ou peut-être noyé dedans jusqu'au cou m'importe peu. Si la variété, c'était Paddy McAloon sur les ondes, je mettrais Rtl2 tous les jours.

Ensuite, un peu moins bon, mais quand même ravissant, il y a le cas des Pale Fountains (et de Shack). Encore un grand moment d'élégance. Sorti en 1984, année de ma naissance, Pacific Street reste un disque de grand talent. Unless, par exemple, avec ses synthés pourris, résiste à toutes les modes. Mais la chance est d'avoir encore aujourd'hui un groupe de ce niveau, quoique plus timide: Belle and Sebastian. Beaucoup les trouvent mièvres et niais. Mais si vous avez lu mon post sur Donovan, vous devez savoir que je ne condamne jamais arbitrairement un peu de mièvrerie. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vraiment cherché à comprendre ce que chantait Stuart Murdoch. Les mélodies, imparables, me suffisent.
Si vous avez, dans cette veine, des suggestions, je réitère ma demande. Rien ne me plairait davantage que de faire tomber mes préjugés sur l'Angleterre et de la voir sous un autre jour, plus diversifié.(1)
En attendant, voici un petit florilège de mes disques et groupes anglais préférés:
Steve McQueen - Prefab Sprout
Pacific Street - the Pale Fountains
Parachute - the Pretty Things
Sticky Fingers - the Rolling Stones
Belle & Sebastian
the Beatles
Spiritualized
Astral Weeks - Van Morrison
Spirit of Eden - Talk Talk
What We Did On Our Holidays; Unhalbricking ; Liege and Lief - Fairport Convention
Mais aussi, dans une moindre mesure : Donovan, the Coral, Badfinger, the Animals, Richard Hawley, Jesus and Mary Chain, the Cure, Stone Roses, Pink Floyd.
(1) Pour prévenir les remarques concernant un éventuel oubli, j'ajoute que je n'aime pas énormément les Smiths.
mardi 6 octobre 2009
des chansons en or (4)

Vous allez me dire gâteux mais n'importe. Cette chanson est selon moi une des dix plus belles au monde, en même temps qu'une des plus niaises dans sa forme (car l'intention, elle, est délicate). Ce n'est pas sa plus connue (qui n'est d'ailleurs pas terrible - mellow yellow) et il s'agit en outre d'une dédicace, à Derroll Adams, alias le "banjoman", qu'on trouve à la fois sur l'album A Gift from a Flower to a Garden et sur le tribute à Adams.
Ce dernier était (il est mort à l'orée de la décennie) un chanteur country discret, qui avait émigré en Belgique, peut-être en raison de ses idées communistes. Il avait sympathisé avec Donovan Leitch, voire l'avait parrainé, à l'époque où celui-ci souffrait de la comparaison avec Bob Dylan. Alors que la presse se moquait facilement de son air candide de gamin attardé, Adams avait quant à lui réservé toute sa considération au troubadour écossais, qui le lui avait rendu sur ce superbe hommage, une des seules compositions originales d'un disque majoritairement constitué de reprises.
Ce n'est pas une maigre surprise que de constater la suprématie musicale de Donovan sur tous les autres invités ici présents. Peut-être serait-ce aller trop loin que de lui attribuer aussi le mérite de surclasser Adams, son mentor. Pourtant... Ce n'est pas qu'il faille diminuer le talent du banjoman. En fait, il était sans doute meilleur parolier, mais la musique country, nourrie de ses lieux communs, n'a pas exactement l'effet désiré sur l'auditeur européen lambda. Aussi, vue de loin, toutes ces chansons tendent musicalement à se ressembler. Seule tranche cette tendre rêverie, longue et répétitive adresse aux... étoiles de mer, auxquelles Donovan demande des nouvelles de son cher expatrié (bring me word of a banjoman/With a tatoo on his hand).
J'imagine déjà les têtes de mes lecteurs. Donovan parle aux étoiles de mer dans sa chanson? Est-il sorti de l'enfance? Prévoyait-il que les mômes joueraient un jour à Warcraft plutôt que de discuter avec les étoiles de mer? Et pourtant, qui contesterait qu'il y a, même sous une forme naïve, une réelle poésie, non pas dans le dialogue avec une étoile de mer, qui n'est qu'un artefact, mais dans la promenade d'un homme seul le long de la plage, un soir, regrettant de ne pouvoir rejoindre son ami de l'autre côté de la Manche? "Comme je serais content de venir, chante Donovan, comme je serais heureux de partir, si je n'avais pas mon travail à faire et ma face à montrer. Mais je dois me rendre à l'intérieur des terres." C'est déposé d'une voix douce et empreinte de gratitude. Heureux comme un beau jour et nostalgique comme l'homme qui a un pied devant et le regard derrière. La musique, elle, se contente des trois accords de rigueur, mais en l'écoutant, on a le sentiment qu'elle ne tourne peut-être qu'autour d'un accord, tant les variations passent inaperçues (et ce n'est pourtant pas un reproche). On entend tout d'abord le flux et le reflux de l'eau qui clapote. Puis ce n'est rien d'autre qu'un accompagnement de guitare acoustique. Le milieu du morceau voit quand même arriver un banjo (le fameux banjo) et une basse. Rien de plus. Des couplets, pas de refrain. C'est véritablement ce qu'on peut appeler une ballade. Chaque couplet, ou presque, se termine par "the banjoman, with a tatoo on his hand", ajoutant à cette impression hypnotique de ritournelle. Avec l'image de l'eau qui avance et recule, la répétition des mêmes termes à intervalle régulier, la douceur du chant, vous comprendrez que l'auditeur se laisser bercer par une impression de balancement et de flottement très agréable. C'est une musique à écouter comme une berceuse - et passé un certain âge, il y en a qui n'aiment pas ça - mais combien sont touchantes comme celle-là?
EPISTLE TO DERROLL, Donovan, 1966
Banjoman: a Tribute to Derroll Adams, 2002
samedi 3 octobre 2009
Le vilain pas beau!

Parmi les questions que tout critique se pose un jour dans sa vie, il y a celle-ci, cruciale : pourquoi les Strokes, les Libertines, les White Stripes et pas le Brian Jonestown Massacre? En terme d'influence pourtant il n'y a pas de différence. Anton Newcombe est le mentor de toute une génération de groupes psyché: des Warlocks aux Black Angels, en passant par les Raveonettes, on ne compte plus ceux qu'il a inspirés. Alors, quelle est la cause de sa discrétion dans les médias? Pourquoi la galaxie Libertines n'a-t-elle jamais croisé la galaxie BJM? Pourquoi Peter Doherty d'un côté et Anton Newcombe de l'autre, sans réciprocité? Pourquoi la jeunesse retiendra-t-elle de ses beaux jours What Katie Did et pas Open Heart Surgery?

- On peut avancer plusieurs hypothèses. La première concerne directement les médias: il est de notoriété publique qu'Anton Newcombe n'est pas une personnalité facile. Selon le monde entier, sauf le principal intéressé et ceux qui ne le connaissent ni de vue ni d'ouï dire, ce personnage erratique est devenue une véritable épave droguée et alcoolique, mégalomane notoire doublé d'un paranoïaque agressif, insultant copieusement le moindre chien habillé pour finalement lui adresser des signes d'amitié qui sont presque plus flippant qu'une menace ouverte. L'interviewer suppose donc d'être sur le qui-vive. Du coup, il est médiatiquement flingué.
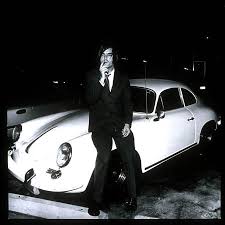
- L'autre hypothèse, hélas vérifiable, tient à l'inégalité de ses disques. La discographie est abondante mais il vaut mieux se contenter du best-of sorti en 2005 (même si certains grands morceaux n'y figurent pas). Dans ses moments les plus psyché, Anton Newcombe est capable de sortir le grand jeu hippie avec sitar et progressions vaguement hindoues. On comprend mieux la désaffection chez ceux qui n'ont pas écouté les bons morceaux. Néanmoins, il y a tant de choses renversantes dans sa discographie qu'on ne peut pas honnêtement passer à côté de tout.

En vérité, la raison de sa faible popularité vient de sa personnalité elle-même. On ne saura jamais dans quelle mesure le film dig! y est pour quelque chose (même s'il est certain que l'image de Courtney Taylor des Dandy Warhols en a pâti) mais le résultat est là: Anton Newcombe a l'image du sale type. Or, ce n'est pas sexy.
Dans le même ordre d'idée, pourquoi Frank Black ne provoque-t-il pas de crise d'hystérie chez les fans d'Adam Green? Pourquoi Sonic Youth et l'indie-rock US "chemise à carreau" ennuient-t-il les amoureuses de Razorlight? Pourquoi les Cave Singers vont-ils se ramasser? Parce que Frank Black est gros et chauve. Parce que le hardcore n'est pas sensuel. Et le folk est un truc de barbus. Ce n'est plus le conflit entre la jeunesse et la vieillesse qui fait la différence (la popularité des dinosaures punk montre bien que c'est faux), c'est l'érotisme, c'est la séduction.
Regardez les Strokes, les Libertines, Adam Green... Ils sont jeunes, sexys, ont l'air cool et chantent pour plaire aux filles et montrer aux garçons qu'ils ont la classe. D'ailleurs, leurs plus grands fans sont de l'autre sexe, complètement hystériques et qui pire est souvent insupportables (mademoiselle, qui que tu sois, tu es sans doute hors du lot). Ainsi, selon toute vraisemblance, la séduction constituerait le pivot de l'éthique rock'n'roll, cette idéologie stupide qui glorifie la jeunesse, la coolitude, la défonce, la fête et les plaisirs libidineux.
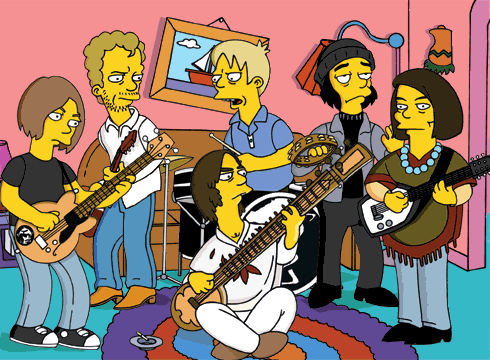
Mais un peu d'individualisme y est bien vu aussi, du moins sous sa forme aristocratique: un bon groupe possède un ou deux chanteurs dotés d'un charisme puissant, attirés par les feux de la rampe comme le papillon par le néon, des grandes gueules dont l'aura se répercute très loin. Anton Newcombe n'est pas loin du compte. Question grande gueule, le type se pose un peu là. Mais il a succombé à l'excès, comme Courtney Taylor, sans toutefois atteindre le même succès: l'un comme l'autre ont forcé le naturel au lieu de se fier à leur aura personnelle. Ils ont viré mégalomanes. Or, le mégalomane est universellement détesté lorsqu'il joue à découvert. La force du séducteur c'est de se faire aimer et non pas de se déclarer supérieur (même si de fait, Anton Newcombe n'est pas orgueilleux sans raison). En rock, la prétention est abhorrée, tandis que l'arrogance morveuse, type écolier rebelle (plus sexy, une fois de plus), entraîne immédiatement l'adhésion et la sympathie (sic). Ainsi, Anton Newcombe n'a jamais soigné son image. Par exemple, il a systématiquement viré ses musiciens (à l'exception d'un fidèle je crois), de sorte que le BJM n'est pas un groupe, mais un collectif à géométrie variable, ce qui empêche de se familiariser avec une petite bande (comme les Beatles) et entretient une image asociale peu ragoutante pour le fan de rock (qui, en général, révère l'amitié). Evidemment des types comme les Gallagher, Lou Reed ou Doherty ne sont pas non plus des modèles d'amitié. Mais ils ont d'autres atouts pour sauver leur image. Et les Arctic Monkeys, eux, plaisent parce qu'ils donnent l'apparence d'une bonne bande de potes.
Mais avec tout cela on ne parle pas musique, me direz-vous. Bin non. C'est du rock. Comme le disait Daniel Darc, si vous voulez de la musique, écoutez Coltrane; le rock c'est l'attitude qu'on a quand on sort dans la rue. C'est un état d'esprit nous martèle rock'n'folk. Et c'est vrai. Une image, en fait.
De ce point de vue, Newcombe a tout faux. Mais pour les quelques uns qui sont sortis du lycée, pour les martiens qui, comme moi, n'écoutent que la voix et la guitare, alors n'hésitez plus: Tepid Peppermint in Wonderland (la rétrospective) est un des objets les plus sidérants du monde moderne. Au diable le rock, le sexe et la drogue dans laquelle Newcombe a fourré son nez, faîtes juste tourner le disque!
vendredi 2 octobre 2009
Deerhoof ou Deerhunter?

Qui a dit que les Beatles étaient universels? En Irak, les GI passaient les fab four pour faire craquer les talibans. Je cite ce fait de mémoire, sans certifier sa provenance. Mais les exemples de toute façon abondent aussi dans nos contrées. Certes, il faut quand même être bien difficile pour trouver insupportables les plus consensuels des artisans de la pop. On ne trouve pas de groupe dans l'histoire du genre qui fédèrent autant de personnes différentes, dans leurs goûts comme dans leurs mœurs. Mais la chose arrive et elle remet en cause les convictions même les plus inébranlables. Cette introduction n'a pas d'autre but, en effet, que d'amener le lecteur à relativiser ce qu'il pense être du domaine de l'Universel (avec un grand U). Quiconque analyse la chose remarque que l'universel est une forme civilisé du narcissisme de groupe: il est l'apanage d'une communauté qui célèbre ses propres valeurs (justifiées par leur caractère très répandu et réciproque). Ceci étant posé, il s'agit également d'une arme rhétorique visant à marginaliser la différence et donc à exclure - au lieu que les naïfs, comme moi, voudraient TOUT inclure.
C'est en tout cas ce que doivent se dire les fans malheureux d'Animal Collective, des Fiery Furnaces et de Deerhoof, trois groupes marginaux peu susceptibles d'accéder à une plus large audience, ni aujourd'hui et encore moins demain, quand (c'est prévisible) le nombre de fans se réduira à une peau de chagrin. Car si ces hommes engendrent comme tout le monde, leurs enfants, eux, n'ont qu'une chance sur un milliard, et encore, d'être atteint par l'hérédité musicale de leurs géniteurs. S'il y a des chromosomes Beatles, ils sont sans doute plus nombreux que les chromosomes Deerhoof (car dans la nature comme dans la société les médias dirigent tout - enfin, c'est ce dont il faut se persuader).
Qu'on en dise cependant tout le mal qu'on voudra, c'est à la gloire de la musique populaire de se soucier moins de la bouteille que de l'ivresse. La nature et la société distribuent les goûts selon des lois sans doute analysables point par point, mais je doute que cela mène à de grands changements. Dans les cas où un peu de snobisme teinte les goûts d'une personne sous influence, on peut toujours l'amener à plus de confiance en soi. Dans les cas, fréquents, où le manque de culture empêche de connaître le meilleur, on peut remédier au problème. Après, si un gars préfère en toute connaissance de cause Chantal Goya au Velvet Underground, qu'est-ce que cela peut faire? Ainsi, laissons tranquilles les zélateurs de Deerhoof, ce sont souvent des gens très cultivés et je ne les soupçonne pas de snobisme (soupçon dont je me fais un scrupule, pour ce qu'il suppose de mécréance et d'incapacité à reconnaître l'altérité). Ils fonctionnent sans doute selon un schéma mental qui m'échappe. On peut tout de même avancer l'hypothèse qu'un fan de Deerhoof se soucie peu ou prou d'émotions et aborde la musique selon un angle plutôt cérébral, résolument non sentimental. N'importe! Brisons-là, il s'agit en fait de parler d'un autre groupe, aussi peu universel, presque aussi barré et très marginal en France: Deerhunter, les chasseurs de cerf. Avec un nom pareil, inutile d'indiquer la provenance. Les USA sont spécialistes des noms d'animaux. Mais Deerhunter n'est pas un groupe de folk-rock. C'est un groupe urbain, dans la lignée de Spacemen 3, Sonic Youth et de l'indie-rock des nineties. Plus isolés que les Warlocks ou les Raveonettes, moins accrocheurs aussi, Deerhunter a frôlé la considération publique l'an passé, du fait de la reprise de Fluorescent Grey par Jay Reatard. Pas de connexions bien profondes entres le leader du groupe sonique et la nouvelle grande gueule de la power pop pour autant. Deerhunter reste un truc underground et audible trois ou quatre fois par semaines aux bas mots. Mais lorsque les conditions s'y prêtent, l'effet peut laisser pantois. Bien sûr, ce n'est pas fulgurant comme l'était Sonic Youth, et puis il n'y a pas le statut d'icône underground pour fasciner le public, mais les guitares de Never Stops, le refrain d'Agoraphobia, le mur du son sur Twilight at Carbon Lake, ou encore la petite valse de Slow Swords parviennent à envoûter l'auditeur accessible à la musique noise autant qu'aux climats planants et hypnotiques. Ce psychédélisme rafraichi peut évoquer tout ce qui s'est fait de mieux dans les vingt dernières années, de Galaxie 500 aux Warlocks, mais avec un supplément de folie. Leur dernier album est un double, difficile à assimiler en une fois donc. A vrai dire, on écoute ce genre de choses bribes par bribes. Mais le format convient peut-être à leur côté prolixe et fourre-tout, à cette volonté manifeste d'exploiter toutes les idées. Quand on les cueille au meilleur d'eux-mêmes, c'est peut-être un des meilleurs groupes en activité. Pour le reste, il y a des longueurs.
MICROCASTLE/WEIRD ERA CONTINUED
Deerhunter
2008, Kranky/4AD
jeudi 1 octobre 2009
des chansons en or (3)

Celle-là, c'est un phare. Aucune influence, aucune hérédité. Black out total depuis des années. San Francisco est juste 1) un hymne à la gloire d'une grande ville 2) un tube adorable, bien au-delà des années 60. Je pourrais vous dire que c'est du niveau de Lennon ou de Ray Davis, mais à quoi bon le préciser? L'homme qui est à l'origine de ce morceau est tout simplement leur égal. John Phillips n'est autre que le leader discret des Mamas and the Papas, quartette populaire d'un compositeur resté dans l'ombre de ses tubes.
Ce type, qui avait l'air plus sympathique que la moyenne, voyait la lumière partout. Il chantait des morceaux tristes sur son album solo et pourtant on n'y voyait jamais que le soleil, la plage, la mer. Un soleil déclinant il est vrai. Mais toujours ces atmosphères en demi-teinte, où la gaieté et la nostalgie marchent de concert, toujours cette même ambiguïté de sentiments...Ce type était le Watteau de la Californie, le Verlaine des bords de mer. La même grâce, le même léger badinage. Pour moi, rien n'est jamais franchement triste chez lui, ce serait plutôt une nuance délicate du bonheur, une subtilité suave et rare. Mais le compositeur de chansonnettes ne se contentait pas d'écrire pour lui et son groupe. Il donnait aussi aux proches. Un jour l'idée lui vint d'abandonner une chanson à son ami Scott McKenzie, peu doué pour la composition mais indéniablement meilleur chanteur. Et on aura beau dire, spontanéité oblige, l'esthétique do it yourself, tout le baratin punk, ça vaut peut-être pour la valeur expressive, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait la pop. La pop est une fabrique, un artisanat, il faut de bons interprètes, une voix solide. C'est léché, travaillé, retapé...et ça donne un tube aussi splendide que celui-là, quelque part entre la gaieté d'une période sans nuage, le havre de paix qui ravive des nostalgies vagues, des rêves d'Eden un peu niais mais doux pour l'esprit, et, toujours, ce sentiment trouble, cet élan qui magnifie pendant quatre minutes la vie de l'auditeur. Très fort!
San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In Your Hair)
in SAN FRANCISCO, 1967 sony music
Scott McKenzie
Inscription à :
Articles (Atom)