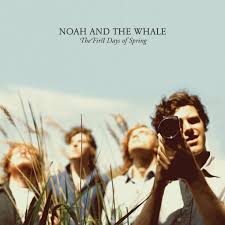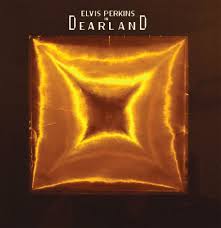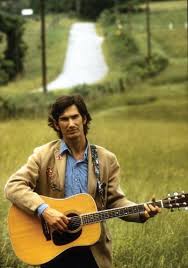Le problème avec Low Anthem c'est qu'on ne sait jamais si on aime par habitude, ou si on aime parce que c'est vraiment bien. Ou peut-être qu'on aime une moitié de l'album et beaucoup moins l'autre, mais que la bonne moitié a aidé à faire passer la seconde. En fait, et ça tout le monde vous le dira, c'est comme s'il y avait deux groupes: un premier qui joue une musique folk éthérée et monocorde et un second qui braille dans le micro un rock de cabaret enfumé et crade. D'un coté une voix d'homme émasculée qui s'étire dans un long bâillement (Ohio, Charlie Darwin), de l'autre celle d'un buveur de whisky qui postillonne généreusement dans le micro (the Horizon is a Beltway). C'est pourquoi le magazine Eldorado n'avait pas dit une sottise en prétendant que ce disque plairait à la fois aux fans de Bon Iver et à ceux des Felice Brothers. On peut aimer l'un sans aimer les autres, mais on si on aime un des deux, on aime Low Anthem. Cela me paraissait abscons. Je comprends mieux en voyant la schizophrénie à l'œuvre.
Mais, au fait, qui sont les Low Anthem? Ce sont trois jeunes gens de Rhode Island: deux amis de l'université et une musicienne classique, également technicienne de la NASA (toujours impressionnant de lire ça). A trois, ils jouent de la folk sans être encombré par leurs classiques. Il y a bien une reprise de Tom Waits, mais à part ça, on les sent dégagés d'influences pesantes - pas de Dylan dans le coin, pas d'imitation ostentatoire (en cela, ils me semblent plus libres que les Felice Brothers, plus modernes aussi). Ce qu'il y a de plus spécifiquement américain dans leur musique, c'est qu'on y sent affleurer un goût pour les grands espaces, à travers l'harmonica et les arpèges tranquilles de guitare acoustique. Ce sont essentiellement des musiciens, des personnes capables de savourer le simple son d'une corde de guitare, celui d'une résonance prolongée ou d'un léger souffle de flûte. C'est peut-être pour cette raison qu'à force de les écouter, dans leurs moments les plus tranquilles, on finit par les apprécier: leurs amours sont contagieuses. Mais, n'exagérons rien, les meilleurs morceaux sont les plus durs, en particulier l'immense Champion Angel, certainement leur chef d'œuvre. Je serais prêt à me lever tous les matins à cinq heures pour en sortir un comme ça. L'écoute s'impose.
OH MY GOD, CHARLIE DARWIN
The Low Anthem
2009, Bella Union